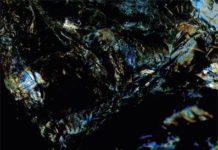Pendant des années, Bonamassa ressemblait à un de ses rentiers, profitant de la nostalgie ambiante pour rafler la mise en séduisant les plus de quarante ans. Cette classe d’âge, qui contient une bonne part des derniers partisans du cd , a surtout grandit avec des modèles qui leurs imposaient une certaine curiosité culturelle.
De Dylan à Springsteen, ou de Rory Gallagher à Jimmy Page , en passant même par les avant-gardistes les plus fous , tous étaient des sages dont le charisme puisait ses racines dans une grande tradition musicale. Ces artiste construisaient ainsi un passionnant labyrinthe , à partir duquel chacun construisait sa propre vision de ce grandiose héritage qu’est la musique américaine.
Mais Bonamassa fut, pendant des années, paralysé par le poids de cet héritage, ses disques sympathiques ayant le même charme que ces rues, qu’on a fréquenté pendant des années sans s’en lasser totalement. Dernier disque en date, Redemption fut un tournant, le monument poli par un artisan parvenu à une maîtrise total de son art.
Sur scène, Big Joe a toujours eu cette maîtrise, la liberté offerte par ses performances lui permettant de se réapproprier sa culture sans avoir peur de la dénaturer. On conseillera d’ailleurs aux curieux de jeter une oreille à ce live à Amsterdam , grande célébration dirigée par la voie déchirante de Beth Harth , et portée au nirvana par son guitariste d’un soir.
Même sans sa prestigieuse invitée , Bonamassa parvient ici à emmener le blues vers des sommets qu’il n’a atteint qu’à quelques moments historiques. On en vient même à se demander si le manque d’assurance, qui le mène à servir de mercenaire pour des causes plus ou moins honorables, n’est pas une perte de temps.
Avec le temps, black country communion entre dans une routine abrutissante, qui ne peut satisfaire que les partisans d’une nostalgie mortelle pour le rock. Quant à Beth Harth , elle a prouvé sur son dernier disque que sa créativité ne dépendait pas de son soutient , aussi brillant fut-il.
Alors Big Joe redevient le vieux routard solitaire, retraçant ses expériences, dans une prestation aussi délicieusement solennel que les chants des peuple opprimés qui firent naître sa musique. Le piano marque l’ouverture de la cérémonie sur un ton grave, avant que « This Train » n’embarque le public sur un rythme furieusement rock’n’roll.
On retrouve, dans cette rythmique cadencée, dans cette guitare grondant comme le moteur furieux d’un hard rock déchirant, la même force irrésistible qui parcourait « train kep’t a rollin » , le classique des yardbirds dynamité par Aerosmith. Le touché de Joe est toutefois plus fin, souligné par des chœurs gospel signalant le départ de notre homme sur la longue route du rock’n’roll.
On trouve, dans ses interventions mesurées, un pont entre l’économie d’un Keith Richard et les ponctuations grandiloquentes et lumineuses de BB King. Si le titre s’achève sur un épanchement bavard, prétexte à de grandes digressions solistes, elles ne doivent leurs charismes qu’à ses passages rythmiques, véritable rail, sur lequel les solos de Joe dévalent la piste.
Globalement, big Joe est plus discret qu’à son habitude, et laisse les cuivres lui ouvrir la voie royal sur un Mountaing Climbing en forme de boogie classieux. La classe, notre homme l’aura tout au long de cette prestation, où il semble réinventer le grand spectacle imaginé par ceux qui purent sortir de leurs déchéances, pour transformer leur spleen en un spectacle grandiose.
Une bonne partie de ce live brille de cette rage contenue , de ce subtil mélange de mélodies et de saillies revigorantes qui fait le grand rock’n’roll , et qui culmine sur blues of desperation ridiculisant tout ce que le black country communion a pu produire de bon.
La guitare de Bonamassa ne s’y affirme pas comme un énième descendant appliqué de Jimmy Page , mais bien comme une consœur. Les deux guitaristes parlent le même langage et, alors que la plupart des artistes de sa génération en sont encore réduit à des imitations puériles, Big Joe crée sa propre légende à partir de ce même vocabulaire.
C’est aussi pour cela que, autant que ces saillies hurlantes, ses ballades bluesy sont impressionnantes de maturité. Sur drive et autres No Good Place For The Lonely , il réussit un exploit qui n’a plus été accompli depuis le premier disque de Johnny Winter : il donne une nouvelle définition à cette vielle machine fascinante qu’est le blues originel.
Alors , loin de moi l’idée de statufier l’homme , de lui coller le titre ronflant de gardien du temple que tous voudraient le voir porter . Les lendemains s’annoncent radieux, alors ne clouons pas cette artiste au sol au moment où il commence seulement à décoller.