
Le ferry accoste enfin à Londres, Athènes du rock moderne , ville lumière où les fantômes de l’âge d’or se côtoient. Au détour d’une rue, une plaque rappelle l’endroit où Bowie pris la photo de Ziggy Stardust, et le fleuve qu’il a traversé se rappelle encore du jour où les Sex Pistols gâchèrent le jubilé de la reine. Même dans cette ville qui connut toute les extravagances, le look de Bonamassa fait sensation.
Avec son costume et ses lunettes noires, il ressemble à ces vieux bluesmen qui, ayant trouvés la fortune au bout de leurs chemins misérables, imitent la classe des grands barons du jazz. Il faut dire que, en ce mois de janvier, notre bluesman américain rend visite aux spectres les plus vénérés de la grandiose Albion.
C’est à Abbey Road que fut enregistré Royal Tea , qui se présente comme l’hommage du yankee aux grands rockers anglais. Mais qu’entend-il donc par bluesmen anglais ? S’est-il restreint pour trouver le secret du feeling de Keith Richard ? A-t-il au contraire travaillé son jeu pour reproduire le faste Claptonien ? S’est-il gavé de rhythm and blues pour ressusciter la folie explosive des Who ? A moins qu’il ait simplement profité des moyens de son légendaire studio pour donner à son blues une inventivité pop.
Et bien il a fait tout cela, et c’est bien le problème. Il existe deux types d’artiste, les inventeurs et les suiveurs , et Joe ne supporte pas de faire partie de la seconde catégorie. Le live à Sydney et Redemption lui ont permis de donner un peu de fraicheur à sa musique, ils représentaient apparemment une limite qu’il ne peut dépasser. Le drame, pour une groupie créatrice comme lui, c’est qu’il ne peut se diversifier sans se perdre dans ses références.
Royal Tea s’ouvre sur une fanfare symphonique, qui ouvre la voie à une guitare Pagienne. Cette entrée est enivrante, on se laisse facilement bercer par ces violons caressant des arpèges délicats. Lointains echoe de la face caché de la lune, les cœurs soutiennent une montée en pression pleine de promesse.
Puis Joe retombe dans ses vieux travers, salissant cette nappe finement ciselée à grand coup de solos masturbatoires. Sa diarrhée de notes détruit le bolero qu’il construit ensuite, et dont il accentue la violence avec une vulgarité de heavy metalleux. Ses solos obèses ont l’allure d’un éléphant massacrant sa porcelaine sonore.
Entre l’économie et l’extravagance, entre la violence et le raffinement, Joe est incapable de choisir. Ses quelques réussites sont celles qui renouent avec son Amérique natal , celle où l’imitateur doué ne se prend plus pour le nouveau Mccartney.
Et ce ne sont pas ses cœurs mystiques qui nous feront oublier son boogie blues venue du delta. Tombé dans le piège qu’il s’est lui-même tendu, Bonamassa nage dans le rock anglais comme un gros poisson yankee perdu au milieu du canal de Bristol. Et il ne sert à rien d’appeler le chien de Pink Floyd (dogs sur animals) , sur le break de « Why does it take so long to say goodbye » , même lui ne peut guider un tel aveugle.
Royal Tea esquisse ses références comme un enfant tentant de reproduire les animaux vus au zoo. Les hard rockers pourront toujours se réjouir devant la puissance de solos flirtant avec la beauferie de Judas Priest et autres Iron Maiden.
De l’Angleterre, Joe Bonamassa ne semble avoir retenu que le côté artificiel, et il la restitue avec une grossièreté artistique digne des films Marvell, si l’on peut qualifier ces « films » d’artistiques. On trouvera bien un ou deux riffs à sauver du désastre, mais l’écoute d’un tel disque ne peut qu’inciter tout rocker à ressortir le vieux slogan du PCF : US GO HOME !


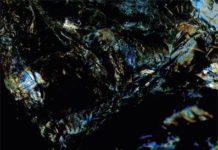


![[CONCOURS] Gagne tes places pour MAGMA au Moulin de Marseille le 10 Mars !!](https://www.daily-rock.com/wp-content/uploads/2016/07/pixies.jpg)