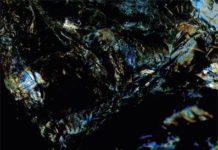En ces temps mornes, Eric essaie d’oublier son spleen dans les rues arrageoises. La ville est une de celles qui se rapprochent le plus de la perfection française, ses bâtiments baroques faisant cohabiter moderne et ancien, dans une harmonie que Londres ne parvient même pas à effleurer.
A part ça, Arras n’avait d’intérêt que pour sa belle librairie, qui a l’avantage de contenir quelques classiques de la beat generation. Il y a bien aussi le furet du nord, mais il reste limité au tout venant. Heureusement, la nostalgie commence à faire du pognon, et le rock est de nouveau rangé en tête de gondole. Lucifer et autres Blackberry Smoke tendent ainsi leurs bras à un Eric bien trop amoureux de riffs électriques pour résister.
Il faut néanmoins avouer que la formule, aussi grandiose soit-elle, commence à rouiller. Lucifer a beau reprendre un tube des Stones, on a toujours l’impression d’entendre Black Sabbath jouer avec Patti Smith.
Enfin, un espoir finit par naitre avec l’installation d’un petit disquaire assez proche de la gare. Eric voyait les disquaires comme des oracles, des éclaireurs guidant la jeunesse dans la jungle pop. Il faut dire que, jusque-là, il ne connaissait que les passionnés des foires aux disques.
Il ne pouvait donc s’attendre à la surprise qui l’attendait derrière la porte vitrée de la petite boutique. A peine entré, le taulier vient rapidement à sa rencontre.
« Salut, tu cherches quoi ? »
L’affaire commence mal. Le type l’accoste déjà comme un dealer, utilisant le ton infantilisant si répandu à notre époque. Eric est majeur et vacciné, et aimerais qu’on évite de s’adresser à lui comme si il était encore en culotte courte.
« Rien, je jette juste un œil. »
Le type semble un peu déçu de la froideur de la réponse, ce qui ne lui enlève pas son ton de surveillant de kermesse.
« Ok , n’hésite pas à demander si tu as besoin ».
Eric ne répond pas, il a déjà la tête dans les étagères. Entre deux étagères Ikea, des sachets de cafés bio exposent fièrement leurs labels « agriculture responsable ». Ce genre de lieu finira aussi par tuer le rock. Comment veux-tu faire passer cette musique pour un hymne à la révolte, quand elle est vendue à coté de dosettes hors de prix ? Ajoute à ça les peintures d’artistes pour snobs mondains, et les prix exorbitants des vinyles, et tu croirais presque que le rocker moyen travaille pour Yann Barthes.
Tout en ressassant ses réflexions, Eric a enfin mis la main sur la relique qu’il cherchait. La pochette n’avait ni nom de groupe, ni nom d’œuvre, qui étaient précisés par un petit sticker collé sur le blister.
Il tendit rapidement le vinyle au vendeur pour une première écoute.
« Ty Segall and Wasted Shirt ? Je me demande ce qu’il devient, perso j’ai lâché depuis quelques jours. »
Tout en ouvrant soigneusement le blister, le vendeur développa une réflexion soporifique face à laquelle Eric se contenta d’acquiescer.
« Dommage que ce mec soigne si peu ses productions. Il tenait quelques choses sur Freedom Goblin et Manipulator. Ce sont les disques qui m’ont fait accrocher, et puis j’ai essayé d’approfondir. C’est sans doute la plus grosse déception musicale de ma vie, je ne me rappelle que de Emotional Mugger. Quelle daube ! »
Là, le type lève la tête, comme si il croyait voir dans la mine pensive d’Eric une approbation.
« Ty va juste trop loin. Faut qu’il redescende. »
Voilà ! Ces quelques mots résumaient parfaitement la mentalité de veaux abrutis par des années de conformisme musical. La réflexion obligeait Eric à réagir.
« Vous voyez , c’est exactement ce qu’on disait de Beefheart et du Velvet dans les sixties. »
Doté d’un enthousiasme inébranlable, l’homme sortit de son comptoir la dernière réédition du premier Velvet.
« Tu fais bien de me parler de ça, j’ai reçu le premier Velvet aujourd’hui, et en plus le vinyle sent la banane. »
« Heureusement qu’ils ont pas réédité Sticky Fingers. J’ose pas imaginer l’odeur qu’il aurait eu. »
Le vendeur n’eut pas le temps de répondre à ce sarcasme, la platine avait enfin lancé la lecture de Fungus II. « AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! » l’introduction de l’album avait fait sursauter toute la boutique, et les clients fuyaient rapidement cette sauvagerie assourdissante.
Eric était fasciné, cette crise de nerf électrique est le plus grand disque depuis la sortie de « White Light/White Heat » . Il n’y a pas de chant ici, juste des hurlements, qui sont autant de doses de vitriole pour tympans encrassés. Les mélodies aussi sont totalement absentes, pour ne pas diluer la violence de ce monolithe corrosif.
La batterie, séche comme un coup de trique, guide les riffs délirants dans un chaos plein de distorsion. On tient ici le Pulp Fiction du rock , un puzzle mystérieux dont la puissance semble balayer trente ans de vide artistique. Seul « Four Strangers Enter the Cement at Dusk » s’ouvre sur un tempi sabbathien bien connu des fans de Fuzz.
Puis, rapidement, le rythme s’emballe de nouveau, au point que ces distorsions ultras rapides semble sorties d’une platine mal réglée. C’est le disque d’un homme qui a enfin quitté tous ses repères, et abandonne toute mélodie et autres normes musicales. On a affaire à l’expression froide de cette rage destructrice qui devrait toujours faire partie du rock.
Les rares personnes restées dans la boutique semblent agressées par chaque note de ce brasier sonore. Fungus entre de force dans leurs cortex cérébraux, et vomit copieusement sur toutes les références rances qui s’y sont nichées.
Alors, forcément, quand même les plus acoustiques « The Purple One » et « Double The Dream » débouchent sur un autre chaos électrique, le conformisme ne peut s’empêcher de faire taire le blasphème.
« Virez moi cette horreur ! »
Ces mots furent prononcés par une vieillarde de 20 ans, prouvant ainsi que Fungus rendait le rock aux jeunes.